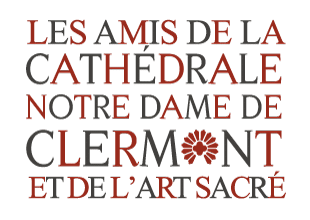17 Avr Sarcophage romain de la Cathédrale : commentaire du Père Eric Bidot, o.f.m.
Nous avons eu la joie d’apprendre la nomination le 15 avril du Père Eric Bidot, capucin, comme évêque de Tulle.
Le Père Eric a passé de nombreuses années, de 2006 à 2015, à Clermont-Ferrand, où il avait été ordonné à la Cathédrale le 29 juin 2007.
Il nous avait donné alors un commentaire spirituel du sarcophage romain de la cathédrale, beau commentaire du parcours des chrétiens vers Pâques!
Nous le félicitons chaleureusement de sa nomination!
Les Amis de la Cathédrale et de l’Art sacré
Plusieurs scènes ont été identifiées sur ce sarcophage. Ces scènes mettent en valeur des personnages et des éléments :
Les deux scènes du côté :
Les Rameaux. La Passion de Jésus fonde le baptême.
La samaritaine. L’eau vive du baptême est proposée comme un don de Dieu.
De gauche à droite :
Moïse frappant le rocher dans le désert. Saint Pierre, nouveau Moïse. Miracle de la source. Nouveau peuple de Dieu.
L’aveugle-né conduit à Jésus. Guérison des yeux, illumination de l’âme. Lumière de la foi. Ecoute de Jésus et vision de l’enfant. Les trois âges. Christ médecin.
La femme en prière : le catéchumène, en Eglise avec Pierre et Paul.
La femme hémorroïsse touchant Jésus. Femme adultère relevé de son péché.
Jésus ressuscitant Lazare.
Tout s’éclaire quand nous cessons de considérer les scènes indépendamment, mais que nous lisons le sarcophage de gauche à droite. Saint Pierre est tourné vers notre gauche, le Christ ressuscitant Lazare est tourné vers la droite : les personnages esquissent un retournement, figure de la conversion du chrétien au long de sa vie. Le néophyte, jeune enfant dans la Foi, venant de recevoir le baptême et présenté par l’Eglise est béni par le Christ ; le pécheur, présenté par l’apôtre et venant au contact de Jésus, est accueilli par lui ; mais au final, le chrétien se retrouve seul face à son Dieu, et sauvé par Lui.
Cela est complété par les scènes latérales : c’est le Christ entrant à Jérusalem qui, par sa Passion fonde le baptême ; face à Marthe, sœur de Lazare, Jésus proclame : « Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra »; et à la Samaritaine, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura plus jamais soif, au contraire, l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant jusqu’à la vie éternelle. »
Les deux scènes latérales soulignent par un chiasme cette espérance, l’eau vive du baptême offerte par le Christ à la Samaritaine, et la Résurrection de Lazare faisant face à l’entrée à Jérusalem.
La catéchèse baptismale, traduite en images, balise toute la route du chrétien, du baptême à la Résurrection, avec son parcours : eau du salut, vocation, Foi, délivrance du péché, Vie éternelle. La grande nouveauté du Christ est l’espérance de la résurrection : c’est elle qui transparaît dans l’harmonie, la sérénité des figures de ce sarcophage.
Un moine orthodoxe écrit avec raison que : « l’homme qui n’a jamais senti qu’il est exilé de Dieu et de la vraie vie ne comprendra jamais ce qu’est le christianisme. Et celui qui est parfaitement chez lui en ce monde et dans la vie de ce monde, qui n’a jamais été blessé par le désir nostalgique d’une autre réalité, celui-là ne comprendra jamais ce qu’est le repentir ».
Un théologien franciscain, saint Bonaventure a également écrit, il y a sept siècles « Sur la terre… nous pouvons contempler l’immensité divine à travers le raisonnement et l’admiration ; et dans la patrie céleste, à travers la vision, lorsque nous serons faits semblables à Dieu, et à travers l’extase… nous entrerons dans la joie de Dieu » (Bonaventure, La connaissance du Christ, q. 6, conclusion)
Ces deux observations me semblent convenir et prolonger l’itinéraire de foi et la démarche sacramentelle que E. H. a évoqués, à partir de ce sarcophage paléochrétien. J’insiste sur les expressions fortes de ces deux citations : « exilé de Dieu », « la vraie vie », « le désir nostalgique d’une autre réalité », « le repentir », « l’immensité divine », « le raisonnement et l’admiration », « semblables à Dieu », « nous entrerons dans la joie de Dieu ». Ce sont des expressions que pourraient prononcer des catéchumènes, des recommençants, des adultes connaissant des conversions personnelles au cours de leur vie chrétienne

.
.

Nous procéderons dans cette lecture spirituelle en trois étapes. Pour allier démarcher sacramentelle et itinéraire de foi, il m’est apparu qu’un auteur médiéval comme saint Bonaventure était tout indiqué : il structure la vie d’union à Dieu en trois étapes classiques : la voie purgative, la voie illuminative et la voie unitive. « La purification conduit à la paix, l’illumination à la vérité et la perfection à la charité » (De triplici via 1, 1). Ces voies ne sont pas des degrés comme les barreaux d’une échelle. Ce sont des séries d’actes qui conduisent à l’acquisition de la perfection, c’est-à-dire à la constance et à la persévérance de l’homme intérieur qui est fortifié et ouvert à l’action de Dieu. C’est le retournement ou la conversion à l’œuvre : Jésus accompagne cette conversion en nous rejoignant par cette proximité qui se fait cheminement.
- La purification consiste dans l’expulsion du péché : l’aveugle-né qui voit et distingue le bien et le mal. E. H. a employé cette expression : « sortir de la mort pour vivre en vérité ». C’est cela expulser le péché ; cela ne veut pas dire ne plus pécher mais être fort et clair dans le choix du bien.
- L’illumination consiste dans l’imitation du Christ doux et humble de cœur : la femme hémorroïsse qui touche le manteau du Christ et est « touchée » par lui en son cœur et son corps ; la femme adultère guérie et envoyée selon la loi de la miséricorde
- L’union dans la réception de l’Epoux : la résurrection de Lazare. Jésus touche le défunt. Dans la doctrine des sens spirituels, le toucher est le sens de l’union à Dieu car on ne peut toucher sans être touché. Le contact est réciproque.
A la purification correspond l’aiguillon de la conscience (figure du Père, juste et miséricordieux). A l’illumination correspond le rayon de l’intelligence (la figure du Fils). A l’union correspond la flamme de la sagesse (figure de l’Esprit Saint).
Voilà comment le baptême, sacrement de l’illumination, peut déployer toutes ses « potentialités » dans les âges de la vie de foi.
Et je peux justifier ce choix en référence à un sermon de saint Bonaventure pour le 2ème dimanche de Pâques qui fait le lien entre la Passion du Christ et les trois voies (cf Entrée de Jérusalem le jour des Rameaux, sur la face gauche du sarcophage) : « La Passion du Seigneur est décrite sous trois aspects : d’abord, évoquer le prix qui nous rachète quand il dit : Le Christ a souffert pour nous, c’est-à-dire pour notre rédemption ; pour nous donner l’exemple qui nous donne la direction, lorsqu’il ajoute : vous laissant un exemple c’est-à-dire pour notre orientation ; pour nous indiquer la trace qui nous conduit, lorsqu’il termine : pour que nous suivions ses traces, dans une parfaite imitation. »

.
.

- La voie purgative : la vue (aveugle-né)
Dans son Itinéraire de l’esprit (ou de l’âme) vers Dieu (chapitre 4, 1), Bonaventure écrit, tout en rapport avec la scène de l’aveugle-né qui est guéri par Jésus : « Il semble étonnant que, Dieu étant si proche de nos âmes, si peu d’hommes s’appliquent à le contempler en eux-mêmes. La raison en est que notre âme distraite par les sollicitudes de la vie, obscurcie par les vains fantômes de ce monde, entraînée par les concupiscences, demeure étrangère aux enseignements de sa mémoire et aux lumières de son intelligence, et qu’elle est sans désir pour les joies spirituelles et la suavité intérieure qu’elle pourrait goûter au-dedans d’elle-même. Plongée tout entière dans les choses sensibles, elle devient impuissante à trouver en elle l’image de Dieu. Et comme il est nécessaire que l’homme demeure où il est tombé si personne ne lui vient en aide et ne le relève, ainsi notre âme tombée au milieu des choses sensibles n’a pu se relever parfaitement, pour se contempler et admirer en elle-même la vérité éternelle, qu’au jour où cette vérité, revêtant en Jésus-Christ la forme de notre humanité, est devenue une échelle nouvelle réparant les ruines de cette échelle ancienne qui avait été formée en Adam. Ainsi nul, quelque éclairé qu’il soit des lumières de la nature et de la science, ne peut rentrer en soi-même pour s’y réjouir dans le Seigneur, s’il n’est conduit par Jésus-Christ, qui a dit : ‘Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé’ (Jean 10) ; il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Or, pour approcher de cette porte du salut, il faut croire et espérer en Jésus, il faut l’aimer. Il est donc nécessaire, si nous voulons entrer dans les délices de la vérité, comme dans un lieu de félicité, d’y arriver par la foi, l’espérance et la charité de Jésus-Christ, le médiateur entre Dieu et les hommes, l’arbre de vie planté au milieu du Paradis. Notre âme, l’image de Dieu, doit donc être revêtue des trois vertus théologiques qui la purifient, l’illuminent et la perfectionnent ; elle doit donc être reformée, restaurée, rendue semblable à la céleste Jérusalem et devenir un membre de l’Eglise militante, qui est la fille de cette cité divine dont l’Apôtre a dit : ‘Cette Jérusalem d’en haut est Sion. C’est elle qui est notre mère’ (Ga 4). »
L’aveugle-né a eu foi dans les paroles de Jésus : « va et lave-toi dans la piscine de Siloé » (Jean 9, 7). La scène se termine par : « Je crois, Seigneur ». Jésus dit alors : « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » (Jean 9, 40)
Le péché et son influence sur l’homme sont souvent décrits par Bonaventure par : courbure, incurvation : « Selon l’institution première de notre nature, l’homme fut créé apte à goûter le repos de la contemplation, et c’est pour cela que Dieu le plaça dans un paradis de délices. Mais s’étant porté de la vraie lumière à un bien passager, il s’est recourbé sur lui-même par sa propre faute ; sa descendance tout entière s’est incurvée sous le poids du péché originel qui a imprimé à la nature humaine une double misère : l’ignorance de l’esprit et la concupiscence de la chair. Ainsi l’homme est aveugle et assis au milieu des ténèbres ; il ne voit point la lumière du ciel si la grâce, aidée de la justice, ne lui vient en aide ; et tout cela s’accomplit par Jésus-Christ. » (Itinéraire de l’esprit vers Dieu 1, 7). On ne peut aller vers la lumière désormais qu’entraîné et accompagné par d’autres. D’où la présence d’un apôtre.
Pour remédier à cette courbure, Bonaventure évoque la méditation. Pour faire bref, la méditation suppose : la conscience de la négligence qui nous anime, la conscience de la concupiscence ou avidité qui nous anime et la conscience de la malice ou aversion – agressivité qui nous séduit. A la négligence, il faut répondre par l’entrain et la vigueur. A la concupiscence, il faut répondre par la rigueur. A l’agressivité, il faut répondre par la bienveillance et la douceur. Pour se faire, la prière est recommandée, en lien avec les scènes évangéliques, en particulier la Passion de Jésus : aveu de sa faiblesse, sollicitation d’une grâce et adoration, l’adoration se présentant comme l’antidote de la curvitas. La prière est ici liturgique et silencieuse. C’est cela qui introduit dans la contemplation qui est l’ouverture à Dieu.
L’enjeu de cette étape est la guérison du regard (Breviloquium 2, 12, 5) : « L’homme a reçu un triple regard … un regard de chair (extérieur), un regard de raison (intérieur) et un regard de contemplation (supérieur). » Notre regard doit être illuminé par la grâce et la vie avec Jésus. C’est lui la véritable mesure de notre existence.

.
.
- La voie illuminative : le goût et l’odorat (femme hémorroïsse)
Il s’agit, par la méditation, de passer des ténèbres à la lumière. Pour se faire, l’homme a reçu des dons : la création bien ordonnée, le Fils de Dieu venu dans la chair et l’Eucharistie, l’Esprit Saint qui agit. Ensuite, la prière fait rencontrer le Christ, comme les femmes du sarcophage relevées et envoyées, et conduit à l’action de grâces : le Christ miséricordieux et souffrant sa Passion par amour pour chacun de nous. La prière devant la croix est particulièrement évoquée par Bonaventure : la croix est le livre qui contient toute science. Il nous faut ici imiter Jésus dans son humilité, sa dilection pour le prochain et l’adoration véritable, en cultivant l’abnégation, la pauvreté et la patience. Seule la pauvreté exclut radicalement la cupidité qui est le venin de l’amour.
.
.
- La voie unitive : l’étreinte (Lazare)
Développement de l’amour. La méditation est ici le fait d’être enflammé par l’amour de Dieu, au-delà du sensible et infiniment désirable. Méditer signifie comprendre que l’amour supplée tout. La prière passe ici par différents degrés : la suavité, l’avidité, la satiété, l’ivresse, la sécurité, la paix. La dévotion à l’Eucharistie est pour Bonaventure un acte de la vie unitive, sacrement de l’union et de l’incorporation au Christ, nourriture de l’homme en route. C’est le viatique de la guérison de l’homme. La contemplation est alors véritable sagesse, extase, sortie de soi. « Je ne veux te connaître que pour t’aimer Seigneur. » C’est le passage de ce mon au Père (Jean 13, 1). La sagesse, don de l’Esprit Saint : connaissance expérimentale de Dieu, affective et cognitive. L’homme est restauré dans sa déiformité : l’idéal de Bonaventure est le « sage ». La sagesse est une connaissance unifiée de nature existentielle. Sapientia, saperer = goûter, savoir. Le don de sagesse est « elle est la grâce de pouvoir voir chaque chose avec les yeux de Dieu ». Et cela dérive bien évidemment de l’intimité avec Dieu, du rapport intime que nous avons avec Dieu, du rapport des enfants avec leur Père.
Conclusion :
Notre existence est un passage, une Pâque. Comme les Hébreux dans le désert, nous avançons. La dimension ecclésiale du sarcophage a été soulignée (chaque scène représente un apôtre, le Christ et une personne « guérie » : l’enfant, la femme, le mort). Nous sommes le peuple de Dieu qui a soif et faim.
Comment vivre ce passage en ce monde ? Bonaventure répond à la fin de l’Itinéraire de l’âme vers Dieu : « Interrogez la grâce et non la science, le désir et non l’intelligence, les gémissements de la prière et non l’étude des livres, l’Epoux et non le maître, Dieu et non l’homme, l’obscurité et non la clarté; non la lumière qui brille, mais le feu qui embrase tout de ses ardeurs et transporte en Dieu par une onction ravissante et par une affection dévorante. Ce feu c’est Dieu même, et le foyer où il se fait sentir est la sainte Jérusalem. C’est Jésus-Christ qui l’allume par l’ardeur de sa Passion brûlante, et celui-là seul en ressent les atteintes. (…) Mourons donc et entrons dans les ténèbres; imposons silence aux préoccupations, à la concupiscence et à l’imagination sensible. Passons avec Jésus crucifié de ce monde à notre Père, afin qu’après l’avoir vu, nous disions avec Philippe : ‘Cela nous suffit’ (Jean 14), afin que nous entendions avec saint Paul : ‘ma grâce te suffit’ (2 Co 12), afin qu’avec David nous soyons dans la joie et que nous nous écriions : ‘Ma chair et mon cœur ont été dans la défaillance. O Dieu ! vous êtes le Dieu de mon cœur et mon partage pour l’éternité. Que le Seigneur soit béni éternellement et que tout son peuple dise : Qu’il en soit ainsi ! Amen. Amen’ (Ps 2, 26 et 105, 48) ! »